La prison a deux aspects. Tout d’abord l’aspect répressif : venger les victimes et protéger la société des individus dangereux/décourager les individus d’enfreindre la loi. Ensuite l’aspect bienveillant qui réside dans la capacité à offrir aux détenus une éducation ou l’apprentissage d’un travail, pour permettre leur réinsertion dans la société. Mais comme on enferme les pires individus entre eux, vous imaginez bien que l’aspect bienveillant relève parfois de l’utopie…
… surtout lorsque les problèmes s’accumulent (surpopulation des détenus, défaillance du personnel d’encadrement, baisse du budget). Les prisons les plus dures représentent un lieu de fantasme par excellence puisque tout s’y passe loin des caméras…
Animal Factory (Steve Buscemi, 2000)
Le pitch
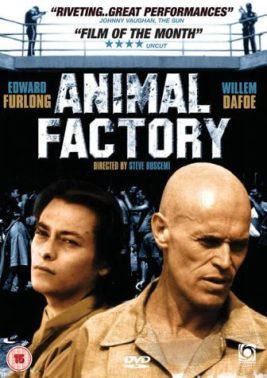 L’existence de Ron Decker, petit dealer de Beverly Hills, bascule le jour où il tombe pour trafic de stupéfiants. Le juge décide de faire un exemple en l’expédiant, en dépit de son âge, à San Quentin, réputée comme étant la prison la plus dure des États-Unis. Ron, qui menait jusqu’ici une vie relativement confortable, n’a rien en commun avec la faune parquée derrière les barreaux de San Quentin. La plupart ont commis des crimes et des viols dans des circonstances abominables, et ont en conséquence écopé de peines qui les privent de tout avenir. Ron comprend rapidement que ses compagnons de cellule n’ont rien à perdre. S’il répond à une provocation, c’est la mort. Il n’a pas le physique, et encore moins la détermination pour se battre, si bien qu’il n’a aucune chance de survie sans aide. Il réclame alors la protection de Earl Copen, un ancien chef de gang respecté qui accepte de le prendre son aile en échange de faveurs sexuelles. Ron rencontre des « femmes », c’est-à-dire des détenus dont la vie ne dépend que de leur soumission envers leurs « maitres ». Ron résiste alors à l’emprise de Earl Copen, tout en sachant qu’il ne peut se passer de son appui. De cette confrontation va émerger autre chose qu’un rapport de force entre les deux hommes. Earl Copen devient progressivement le mentor de Ron, parce que les deux hommes s’apprécient en dehors des logiques hiérarchiques et sexuelles.
L’existence de Ron Decker, petit dealer de Beverly Hills, bascule le jour où il tombe pour trafic de stupéfiants. Le juge décide de faire un exemple en l’expédiant, en dépit de son âge, à San Quentin, réputée comme étant la prison la plus dure des États-Unis. Ron, qui menait jusqu’ici une vie relativement confortable, n’a rien en commun avec la faune parquée derrière les barreaux de San Quentin. La plupart ont commis des crimes et des viols dans des circonstances abominables, et ont en conséquence écopé de peines qui les privent de tout avenir. Ron comprend rapidement que ses compagnons de cellule n’ont rien à perdre. S’il répond à une provocation, c’est la mort. Il n’a pas le physique, et encore moins la détermination pour se battre, si bien qu’il n’a aucune chance de survie sans aide. Il réclame alors la protection de Earl Copen, un ancien chef de gang respecté qui accepte de le prendre son aile en échange de faveurs sexuelles. Ron rencontre des « femmes », c’est-à-dire des détenus dont la vie ne dépend que de leur soumission envers leurs « maitres ». Ron résiste alors à l’emprise de Earl Copen, tout en sachant qu’il ne peut se passer de son appui. De cette confrontation va émerger autre chose qu’un rapport de force entre les deux hommes. Earl Copen devient progressivement le mentor de Ron, parce que les deux hommes s’apprécient en dehors des logiques hiérarchiques et sexuelles.
Note finale : 7/10
Après avoir réalisé les épisodes U.S. Male (1999) et Cuts Like a Knife (2001) de la série télévisée Oz, Steve Buscemi creuse plus en profondeur les thèmes du communautarisme, les conflits ethniques, les gangs, la drogue, la violence sexuelle. La prison est présentée comme la concentration des cancers qui rongent les États-Unis, à la manière d’un miroir grossissant. La jeunesse et la fragilité de Ron, interprété par Edward Furlong (John Connor âgé de 14 ans dans Terminator 2) suscite immédiatement l’empathie. Enfin, la galerie des seconds rôles joue pour beaucoup dans le charme du film (Willem Dafoe, Danny Trejo, Mickey Rourke et Steve Buscemi lui-même). Une réussite, même si la fin sur fond d’évasion laisse dubitatif.
L’Expérience (Oliver Hirschbiegel, 2001)
Le pitch
 Dans le cadre d’une étude comportementale, le professeur Thon enferme vingt volontaires dans un simulacre de prison. Huit d’entre eux sont désignés pour être les “gardiens”, les douze autres étant les “prisonniers”. Tous les cobayes sont sommés de jouer leurs rôles : les gardiens sont chargés de faire régner l’ordre, et les prisonniers réclamer davantage de liberté. Les faits et gestes des cobayes sont rapportés par les caméras de sécurité.
Dans le cadre d’une étude comportementale, le professeur Thon enferme vingt volontaires dans un simulacre de prison. Huit d’entre eux sont désignés pour être les “gardiens”, les douze autres étant les “prisonniers”. Tous les cobayes sont sommés de jouer leurs rôles : les gardiens sont chargés de faire régner l’ordre, et les prisonniers réclamer davantage de liberté. Les faits et gestes des cobayes sont rapportés par les caméras de sécurité.
Au départ, l’expérience est un succès car les gardiens appliquent le protocole, et les prisonniers respectent leur autorité. Cependant le gardien Bérus, qui menait jusqu’ici une existence médiocre, se voit transformé par l’exercice du pouvoir. Il ne laisse bientôt plus rien passer aux prisonniers et son sadisme inspire tellement de terreur aux autres gardiens qu’ils en font leur chef. Bien que la violence soit normalement prohibée de l’expérience, les gardiens sous l’influence de Bérus ne se gênent plus pour humilier et torturer les prisonniers. Le professeur Thon ne contrôlant plus rien, les prisonniers sont à la merci de leurs bourreaux. Ils ne devront leur survie qu’à une révolte massive contre la répression.
Note finale : 7/10
Le film résume brillamment l’étude de psychologie expérimentale dirigée par Philip Zimbardo en 1971 à Stanford. Il s’agit de démontrer que quelque soit la culture ou les principes moraux des individus, l’environnement couplé à une légitimité institutionnelle telle la prison force à changer de comportement : les prisonniers sont poussés à une obéissance servile tandis que les gardiens se métamorphosent en tyrans. En clair, la personnalité individuelle ne résiste pas longtemps face à des situations infantilisantes ou déshumanisantes, qui mènent à un sentiment d’impuissance chez les prisonniers, et de toute-puissance chez les gardiens. Le film constitue une réussite quelque peu malmenée par la fin, assez surréaliste. La véritable expérience de Stanford ne s’est pas autant mal terminée, même si la plupart des sévices infligés aux prisonniers ont bel et bien eut lieu : privation de nourriture, punitions à base d’exercices physiques, interdiction d’utiliser la salle de bain, obligation de nettoyer les toilettes à mains nues, obligation de dormir à même le sol sans aucun vêtement, humiliations sexuelles. Le pire se déroula la nuit, parce que les gardiens pensaient que les caméras étaient éteintes et que l’équipe de recherche ne pouvait pas les voir. Il en résulta que 8 gardiens sur les 24 au total présentaient de vraies tendances sadiques. Quand la réalité rejoint la fiction…
In Hell (Ringo Lam, 2003)
Le pitch
 La femme de Kyle, un américain vivant en Russie, meurt suite à une agression. Le procès qui s’ensuit innocente le meurtrier, car sa famille le protège en corrompant le juge. Kyle décide de se venger et se voit expédié dans la pire des prisons d’Europe de l’Est. Les nouveaux arrivants ne sont que de la chair à broyer lors de combats organisés par les gardiens, dans le but de détourner la violence à leur égard. De victoire en victoire, Kyle devient bientôt un prisonnier respecté. Cependant, il sait pertinemment que la mort l’attend à force d’enchainer les combats. Il utilise alors son charisme pour inciter les prisonniers à se révolter contre l’autorité pénitentiaire et faire cesser les combats clandestins.
La femme de Kyle, un américain vivant en Russie, meurt suite à une agression. Le procès qui s’ensuit innocente le meurtrier, car sa famille le protège en corrompant le juge. Kyle décide de se venger et se voit expédié dans la pire des prisons d’Europe de l’Est. Les nouveaux arrivants ne sont que de la chair à broyer lors de combats organisés par les gardiens, dans le but de détourner la violence à leur égard. De victoire en victoire, Kyle devient bientôt un prisonnier respecté. Cependant, il sait pertinemment que la mort l’attend à force d’enchainer les combats. Il utilise alors son charisme pour inciter les prisonniers à se révolter contre l’autorité pénitentiaire et faire cesser les combats clandestins.
Note finale : 3/10
Ringo Lam n’épargne rien à Jean-Claude Van Damme dans le but d’en faire un acteur crédible : une scène où il parle au fantôme de sa femme décédée, une scène en sanglots, une scène où il a la coupe et la barbe de Sébastien Chabal, une scène de barbotage dans les excréments… De la prison, on ne retiendra pas grand-chose, excepté les clichés déjà véhiculés dans le film de Van Damme Coups pour coups (1991), c’est dire. Reste les combats, filmés de façon “sèche”, c’est-à-dire avec un minimum de trucages à l’écran. Les coups sont retranscrits sans ralenti ni effets spéciaux, ce qui donne de la spontanéité et de l’authenticité aux combats. Le revers de la médaille de cette façon économique de tourner réside dans l’aspect “téléfilm”. Certes, on a mal pour Van Damme lorsque les coups pleuvent sur lui, mais on a davantage mal pour sa carrière. Cela fait une dizaine d’années que les films de Van Damme sont boycottés au cinéma et ce n’est pas In Hell qui l’a relancé. Peut-être que Expendables 2 (qui réunira les stars du cinéma d’action Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis, Dolph Lundgren et Mickey Rourke) mettra fin à cet “enfer” l’année prochaine.
Un prophète (Jacques Audiard, 2009)
Le pitch

A son arrivée en prison, Malik a 19 ans. Il débarque en enfer pour six longues années. Isolé, plus jeune et plus faible que les autres, il sait que ses chances de survie sont minces s’il ne s’adapte pas rapidement. Malik se salit alors les mains pour le compte du clan Corse, qui inspire la terreur aux autres prisonniers. Au fil du temps, il devient même le protégé du “parrain” César Luciani, qui dirige les réseaux mafieux avec l’aide de surveillants soudoyés. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Malik obtient certaines faveurs telles des permissions de sortie, qui sont autant de missions suicide à l’extérieur pour le compte du parrain. Malik est confronté à des situations extrêmes et voit son influence croître à chaque mission réussie, tandis que celle du parrain est en chute libre. Le clan Corse est démantelé, ce qui permet au clan musulman de prendre le pouvoir. Malik saisit l’opportunité de bâtir son propre réseau, aussi solide en prison qu’à l’extérieur, où règnent d’ailleurs les mêmes lois : être victime ou bourreau.
Note finale : 8/10
Un prophète subit deux influences. La première, c’est la série télévisée Oz. Comme Malik au début, Tobias Beecher s’avère une proie facile pour les autres détenus. Il se fait bouffer par le leader des néonazis avant de s’endurcir et devenir un des prisonniers les plus craints d’Oz. L’autre fil conducteur est l’histoire de Ryan O’Reilly, un détenu qui n’a la protection d’aucun gang. Il ne doit sa survie qu’à ses talents de manipulateur. La devise d’O’Reilly est “diviser pour mieux régner” : en parvenant à monter les gangs les uns contre les autres, il accomplit l’exploit de s’imposer comme l’un des leaders de la prison. Malik se sert lui aussi de la haine qu’éprouvent entre gangs les Corses, les musulmans et les gitans pour s’immiscer au-dessus de tous. La deuxième lecture est issue du jeu vidéo : à l’instar de GTA, les gangs sont répartis suivant des critères ethniques et Malik doit accomplir des missions (assassinats, trafic de drogues) pour se hisser en haut de la hiérarchie criminelle. Du déjà vu aux États-Unis, mais pas en France, où les responsables politiques ont du mal à reconnaitre l’importance des communautarismes ethniques et religieux. Cependant, le réalisateur Jacques Audiard fait intervenir des éléments surnaturels qui dérogent à l’aspect quelque peu documentaire (comment la prison change un jeune délinquant banal en fauve) du film. Ainsi, Malik est un “prophète” car il prédit un accident de voiture et voit les fantômes des personnes mortes qui lui sont chères. Ces tours de passe-passe paraissent incongrus, mais je pense qu’ils étaient nécessaires pour ne pas tomber dans le pur recyclage des codes sur la prison.
Bronson (Winding Refn, 2009)
Le pitch
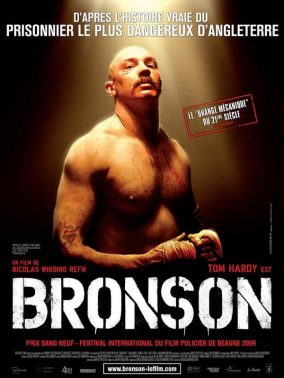 Michael Gordon Peterson est un jeune Anglais tout à fait ordinaire. Le problème, c’est qu’il à l’impression de passer à côté de sa vie, de rater les plaisirs vécus par les grands de ce monde. Il aspire à la célébrité, mais il ne dispose malheureusement d’aucun talent qui lui garantirait de devenir un phénomène médiatique et de connaitre une gloire fulgurante. Les années passent, rendant d’autant plus insupportable le sentiment d’inutilité et la frustration d’un quotidien figé. Si bien qu’il décide de passer à l’acte dans l’urgence, de briser les chaînes de la normalité un beau jour de 1974. Il bricole rapidement son fusil de chasse et s’empresse de braquer la première banque qu’il croise. Il abandonne femme, travail et foyer pour récolter… 26 livres sterling (30€) ! Il est immédiatement arrêté et condamné à 7 ans de prison. Il devrait donc être libre depuis longtemps. En fait, M. G. Peterson a trouvé sa place. Étant heureux en prison, il aggrave sa peine à chaque veille de libération. Il a cumulé à ce jour 35 années d’emprisonnement. Le paradoxe est qu’aucun délit de grande envergure ne justifie ce si long séjour : M. G. Peterson n’est pas fou, il n’a tué ni violé personne. Mais son désir d’être une star, d’être considéré comme “le prisonnier le plus dangereux d’Angleterre” ruine toute tentative de réhabilitation dans la société.
Michael Gordon Peterson est un jeune Anglais tout à fait ordinaire. Le problème, c’est qu’il à l’impression de passer à côté de sa vie, de rater les plaisirs vécus par les grands de ce monde. Il aspire à la célébrité, mais il ne dispose malheureusement d’aucun talent qui lui garantirait de devenir un phénomène médiatique et de connaitre une gloire fulgurante. Les années passent, rendant d’autant plus insupportable le sentiment d’inutilité et la frustration d’un quotidien figé. Si bien qu’il décide de passer à l’acte dans l’urgence, de briser les chaînes de la normalité un beau jour de 1974. Il bricole rapidement son fusil de chasse et s’empresse de braquer la première banque qu’il croise. Il abandonne femme, travail et foyer pour récolter… 26 livres sterling (30€) ! Il est immédiatement arrêté et condamné à 7 ans de prison. Il devrait donc être libre depuis longtemps. En fait, M. G. Peterson a trouvé sa place. Étant heureux en prison, il aggrave sa peine à chaque veille de libération. Il a cumulé à ce jour 35 années d’emprisonnement. Le paradoxe est qu’aucun délit de grande envergure ne justifie ce si long séjour : M. G. Peterson n’est pas fou, il n’a tué ni violé personne. Mais son désir d’être une star, d’être considéré comme “le prisonnier le plus dangereux d’Angleterre” ruine toute tentative de réhabilitation dans la société.
Note finale : 07/10
Comme son modèle, Charles Bronson dans film Le Bagarreur de 1975, M. G. Peterson boxe à main nue. Son comportement ultraviolent avec les gardiens de prison, ou tout homme symbolisant l’ordre, lui accorde enfin le statut de star. Le film raconte cette lente découverte de soi, de combat en combat et de prison en prison. L’acteur, Tom Hardy, est stupéfiant de réalisme. L’esthétisation de la violence, les rapports masochistes et l’érotisation du corps de Bronson sont au cœur du film. Les gardiens, à la fois victimes et bourreaux, peuvent faire subir n’importe quel traitement au corps de Bronson sans jamais pouvoir l’empêcher de se régénérer. Les expériences les plus extrêmes, les chocs les plus durs agissent comme des réponses à la quête d’identité de M. G. Peterson. Ne pas mourir des coups reçus au combat le rend à chaque fois plus fort, et vient lui confirmer qu’il se rapproche du but. Il veut aller jusqu’au bout, aucune blessure ne semble assez grave pour pouvoir satisfaire son œuvre de destruction-révélation. Un film coup de poing, certes, mais on en demandait quand même un peu plus. Ceux qui s’attendent à des kilos de violence seront déçus. Ceux qui exigeaient une réflexion sur l’impasse du système carcéral seront également sur leur faim. Critique complète disponible ici.
Dog Pound (Kim Chapiron, 2010)
Le pitch

Enola Vale est une “fourrière” (Dog Pound), un établissement pénitentiaire pour mineurs aux États-Unis. Le film raconte l’itinéraire chaotique de trois nouveaux détenus : Davis, Angel et Butch. Tous les trois ont moins de 17 ans et ne jouent pas aux durs. Ils sont durs et le prouvent en résistant tant aux humiliations des gardiens, qui tentent de maitriser la violence par la violence, qu’à celles des autres adolescents, qui essaient de les réduire en esclavage.
Note finale : 8/10
Un film d’autant plus dur qu’il ne met pas en scène les fauves de la série Oz, mais de très jeunes chiens enragés. L’environnement carcéral est pour eux une impasse, ils n’ont aucune chance de maitriser l’immense vague de courroux qui les submerge lorsqu’ils sont confrontés à une quelconque forme d’autorité. Ils répondent à la violence parce qu’ils n’ont quasiment plus que ce moyen pour communiquer avec autrui. Aucune chance d’en sortir, aucun avenir à l’horizon. Néanmoins, cette prison où la réhabilitation n’existe pas a malheureusement une triste utilité : protéger le reste de la société à l’abri de ces chiens fous furieux. Reste une question qui dérange : comment en est-on arrivé à un tel déni de civilisation ? Un film cruel, brutal, amer.
Cellule 211 (Daniel Monzón, 2010)
Le pitch
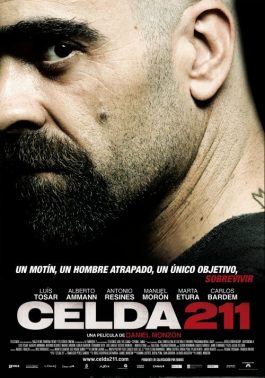 Par zèle, Juan, un gardien de prison, se rend sur son lieu de travail un jour avant sa nouvelle affectation. La prison étant délabrée par endroits, Juan est victime d’un accident et se voit transporté à la hâte dans une cellule vide, la cellule 211. Il se réveille en pleine mutinerie dans le Quartier de Haute Sécurité. Juan n’a d’autre choix que de se faire passer pour un détenu nouvellement incarcéré. L’émeute fait l’objet des médias et les familles des gardiens et des prisonniers affluent devant la prison pour s’enquérir de leurs sorts. La foule massée devant les portes vire à la manifestation, durement réprimée par le service d’ordre de la prison. La femme de Juan, enceinte, meurt sous les coups. En apprenant la nouvelle, Juan se range aux côtés des détenus et tente de diriger l’émeute contre l’autorité pénitentiaire.
Par zèle, Juan, un gardien de prison, se rend sur son lieu de travail un jour avant sa nouvelle affectation. La prison étant délabrée par endroits, Juan est victime d’un accident et se voit transporté à la hâte dans une cellule vide, la cellule 211. Il se réveille en pleine mutinerie dans le Quartier de Haute Sécurité. Juan n’a d’autre choix que de se faire passer pour un détenu nouvellement incarcéré. L’émeute fait l’objet des médias et les familles des gardiens et des prisonniers affluent devant la prison pour s’enquérir de leurs sorts. La foule massée devant les portes vire à la manifestation, durement réprimée par le service d’ordre de la prison. La femme de Juan, enceinte, meurt sous les coups. En apprenant la nouvelle, Juan se range aux côtés des détenus et tente de diriger l’émeute contre l’autorité pénitentiaire.
Note finale : 6/10
Un bon représentant du genre film de prison, avec une volonté manifeste de coller aux faits. Un peu trop, même. Si je n’aime pas les films dont les héros sont des veinards invétérés, je n’apprécie pas davantage les malheureux indécrottables. Noircir excessivement une situation peut avoir comme but de faire rire le spectateur, ce qui est louable dans le cadre de comédies portées sur l’humour noir. Very Bad Things est sans aucun doute le film qui m’a le plus éclaté suivant cette logique masochiste. Cependant, voir le sort qui s’acharne sur un pauvre type ne fonctionne pas vraiment dans un film de prison : le caractère irrationnel et démesuré de la malchance s’accommode mal avec l’austérité et la rigidité du système carcéral. Résultat : on plaint le héros pendant la première demi-heure de film, puis c’est les scénaristes qu’on finit par maudire.

Rédacteur en chef du Vortex. Amateur de Pop-Corn.
Créateur de singularités.







