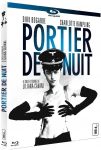Aux yeux du grand public, la provocation et le souffre érotique ont longtemps occulté la dimension esthétique, philosophique et politique des films italiens des années 1970. Choquants, bien que différents du genre sulfureux du film porno.
La question qui nous anime aujourd’hui est la suivante : dans l’histoire du cinéma, pourquoi les films italiens ont-ils été durement dénigrés par la critique lors de leurs sorties respectives au Festival de Cannes ? Pourquoi les trois quarts des films de ce dossier ont-ils été purement et simplement interdits de diffusion en Italie ? Ces films ont-ils encore une raison d’être aujourd’hui, malgré le fait qu’ils ne choqueraient plus ? Réponse avec Les Damnés, Le dernier tango à Paris, La grande bouffe, Portier de nuit, Salò ou les 120 journées de Sodome, Affreux, sales et méchants, Caligula.
Les Damnés (Luchino Visconti, 1969)

27 février 1933. Le vieux baron Joachim Von Essenbeck (Albrecht Schoenhals), propriétaire d’une importante aciérie allemande, fête son anniversaire en famille. Le soir même, l’incendie du Reichstag, le parlement allemand, déclenche la chasse aux communistes par les nazis. Cet évènement est l’occasion de redistribuer les rôles hiérarchiques dans la famille. Le vieux baron destitue Herbert (Umberto Orsini) de la direction de l’entreprise, car il exècre les nazis : « La bonne marche de nos affaires impose des contacts quotidiens avec les nazis. Aussi devient-il indispensable avec moi quelqu’un qui soit bien vu par le régime ». Bien que n’étant pas communiste, Herbert assiste impuissant à son éviction : « Aujourd’hui, les ennemis du Reich sont les communistes. Et demain ? ». Les autres héritiers lui donneront la réponse dans la nuit, en assassinant le vieux baron. Herbert est désigné coupable, tandis que sa femme, Élisabeth (Charlotte Rampling), est dénoncée et déportée dans un camp d’extermination parce qu’elle est d’origine juive.
Devenu actionnaire majoritaire de l’usine suite à la mort du baron, le jeune Martin (Helmut Berger) se fait manipuler par sa mère, Sophie Von Essenbeck (Ingrid Thulin). Martin accorde donc la direction à l’amant de Sophie, un autre arriviste nommé Frédéric (Dirk Bogarde). Les membres restants de la famille Essenbeck vont se déchirer pour prendre sa place, en opérant des rapprochements de plus en plus compromettants avec les nazis : « Les neutres seront les perdants. Nous seront les maîtres ». Une lutte farouche débute entre deux nazis convaincus, le « cousin Aschenbach » (Helmut Griem), membre de la SS, et Konstantin (Reinhard Kolldehoff), un dirigeant de la SA. Le combat pour l’accession au pouvoir entre les deux nazis reflète le conflit macroscopique qui oppose la SS à la SA. Or, l’avenir des deux milices dépend des projets du Fürer pour l’Allemagne. Une fois devenu Chancelier de la République de Weimar le 30 janvier 1933, A. Hitler n’a plus besoin de la SA. La « révolution sociale » et la redistribution des richesses au peuple qu’A. Hitler avait promise aux 4,5 millions de membres de la SA était en réalité un tissu de mensonges. Le Führer trahit ceux qui l’ont soutenu dès 1920 en renforçant la SS et en s’alliant aux milieux conservateurs qui détiennent le pouvoir économique : la bourgeoisie, les milieux industriels et financiers.
Le 30 juin 1934, une centaine de dirigeants de la SA sont réunis et massacrés par la SS à l’aube. Un millier de SA fanatiques sont capturés par surprise au cours de la « Nuit des longs couteaux ». Une fois le corps de la SA démantelé et Konstantin assassiné, le « cousin Aschenbach » peut peser de tout son poids sur la direction de l’usine. Il manipule Martin en le retournant de façon spectaculaire contre sa mère et son amant : « Celui qui veut tout posséder, y compris le droit d’agir et de penser à sa guise, celui-là cesse d’être notre ami ».
L’assassinat du vieux baron symbolise l’accession au pouvoir par la violence et la veulerie, la fin pour les Allemands en l’espérance démocratique. Ceux qui font obstacle à l’ambition des barbares sont changés en boucs émissaires qu’il convient d’éliminer, qu’ils appartiennent aux « races inférieures » (Élisabeth et ses deux filles meurent dans un camp d’extermination), ou au camp des « terroristes politiques » (Herbert « le communiste » est torturé à mort par la Gestapo, Konstantin de la SA meurt fusillé par la SS, Frédéric et Sophie meurent parce qu’ils sont jugés trop modérés par rapport aux nazis fanatiques). Comme l’explique Luchino Visconti, l’avènement du nazisme constitue un tremplin pour les jeunes Allemands ambitieux, sauf qu’il s’agit d’un tremplin pour l’enfer : « Je ne pouvais faire surgir aucune lueur d’espoir dans cette famille de monstres, ce n’était pas possible. Ils sont tous enfermés et asphyxiés par le nazisme. Élisabeth meurt et Herbert se livre à la Gestapo. Ces personnages, les seuls éléments positifs du film, sont aussi perdus parce que le nazisme a été ainsi : il n’y a plus d’issue pour personne ».
 Une des scènes marquantes montre des SA se vautrer dans une orgie. À cette scène de liesse collective s’ajoute une autre encore plus osée, dans laquelle Sophie et son fils Martin se caressent comme deux amants, autant excités par le désir sexuel que l’ivresse du pouvoir. Lorsque Frédéric apprend que Sophie le trompe, il n’est schématiquement plus le « male dominant » de la famille. Martin est en position de force grâce à l’appui de la SS, lié métaphoriquement à la conquête sexuelle de Sophie. Selon L. Visconti, le sexe a une signification particulière dans le film : « Le nazisme s’instaure au sommet de la perversion sexuelle. Le but est de donner une insistance quasi scandaleuse, au sens propre, à l’instauration du nazisme, puisque le film finit quand le nazisme commence. Nous oublions toujours que le nazisme a eu ensuite neuf ans de développement après la fin de mon film et je voulais justement qu’il parte sur un terrain le plus horrible et le plus néfaste possible pour rendre compte de ses neuf années de vie et de tout ce que le nazisme a fait ensuite dans le monde ». La dernière scène du film montre Martin effectuant le salut nazi dans un décor en flammes, tel le diable dans Le jugement dernier (1306) de Giotto Di Bondone.
Une des scènes marquantes montre des SA se vautrer dans une orgie. À cette scène de liesse collective s’ajoute une autre encore plus osée, dans laquelle Sophie et son fils Martin se caressent comme deux amants, autant excités par le désir sexuel que l’ivresse du pouvoir. Lorsque Frédéric apprend que Sophie le trompe, il n’est schématiquement plus le « male dominant » de la famille. Martin est en position de force grâce à l’appui de la SS, lié métaphoriquement à la conquête sexuelle de Sophie. Selon L. Visconti, le sexe a une signification particulière dans le film : « Le nazisme s’instaure au sommet de la perversion sexuelle. Le but est de donner une insistance quasi scandaleuse, au sens propre, à l’instauration du nazisme, puisque le film finit quand le nazisme commence. Nous oublions toujours que le nazisme a eu ensuite neuf ans de développement après la fin de mon film et je voulais justement qu’il parte sur un terrain le plus horrible et le plus néfaste possible pour rendre compte de ses neuf années de vie et de tout ce que le nazisme a fait ensuite dans le monde ». La dernière scène du film montre Martin effectuant le salut nazi dans un décor en flammes, tel le diable dans Le jugement dernier (1306) de Giotto Di Bondone.
Le dernier tango à Paris (Bernardo Bertolucci, 1972)

Paris, 1970. Paul (Marlon Brando), un inconnu, entre dans la vie de Jeanne (Maria Schneider), une bourgeoise de vingt ans sur le point de se marier. En s’accouplant avec frénésie avec sa nouvelle partenaire, Paul cherche à échapper au sentiment de culpabilité qui le ronge depuis le suicide de sa femme. Leur relation alterne entre coïts cathartiques et quêtes vaines en solitaire.
Quelques moments jubilatoires émaillent le film : la scène où le couple, nu, ne communique que par des grognements d’animaux ; où la scène d’initiation à la sodomie dans laquelle Jeanne perd le peu de virginité qui lui restait avec du beurre comme lubrifiant. Peu après, c’est Jeanne qui enfonce un doigt dans l’anus de Paul sur son ordre afin d’assouvir une pulsion homosexuelle. Paul réalise ses propres fantasmes plus qu’il ne guide Jeanne sur la voie du plaisir. Ce père de substitution, décidément trop possessif car désespéré, finit par faire peur à Jeanne.
La scène la plus marquante est celle dans une boite où se déroule un concours de danse. Attablée devant les danseurs de tango, Jeanne découvre le vrai visage de Paul, dont la façade virile s’écroule au fur et à mesure de l’ivresse. Lui qui ne sait rien d’elle, même pas le nom, la supplie de l’épouser. Une trentaine d’années séparent les deux amants, et jamais Paul n’a paru aussi vieux et pathétique. Dans une ultime tentative de retrouver le lien sexuel qui les unissait, Paul la force à le masturber dans la boite, à quelques pas des danseurs. Cette masturbation contrainte met au jour leur véritable relation : Paul est un monstre d’égoïsme qui se sert depuis le début de la faiblesse de Jeanne. La fin s’avère tragique, mais Jeanne délivre Paul du démon morbide qui l’obsède.

Le dernier tango à Paris fut à l’époque victime d’une campagne de calomnie visant à en faire un film pornographique. Quelle grossière erreur ! Les scènes de sexe sont soient sensuelles, soient brutales, mais jamais vulgaires. Enfin, le film vaut surtout pour sa démonstration de l’incommunicabilité des sentiments dans un couple, entre Paul le « père » sadique et Jeanne, la « femme-enfant » masochiste. Lorsque les deux amants jouissent à même le sol sans se déshabiller, ils s’arrachent l’un à l’autre en se roulant par terre. Le ballet des corps, convulsés tant par le plaisir que par l’effroi de retomber dans l’angoisse existentielle, est une juste transposition cinématographique de la peinture Flying Figures (1970) de Francis Bacon.
Le Dernier Tango à Paris au meilleur prix
La Grande Bouffe (Marco Ferreri, 1973, 2h10)

Quatre notables d’une cinquantaine d’années – un juge (Philippe Noiret), un pilote de ligne (Marcello Mastroianni), un restaurateur (Ugo Tognazzi) et un journaliste (Michel Piccoli) – se retirent dans une villa parisienne pour profiter d’un séminaire gastronomique. Les quatre amis ont tous réussi leur vie, sont épanouis et parfaitement heureux. Mais ils ont déjà consommé le meilleur : c’est la vieillesse, la maladie et la souffrance qui les attend. Plutôt que de survivre, ils décident de mettre fin à leur vie comme ils l’ont vécu : dans la joie et la bonne humeur. Le week-end de détente vire à l’orgie gargantuesque.
Pour mieux se gorger d’excès alimentaires et sensuels, les fêtards suicidaires invitent des prostituées à leur table. Sexe et nourriture se consomment à l’unisson : les corps féminins deviennent de la chair appétissante, tandis que la viande se teinte d’érotisme. Le gâteau offert à P. Noiret a les formes de deux seins géants, lui qui chérissait durant son enfance la poitrine généreuse de sa nourrice. M. Piccoli asperge de crème une femme nue. Tout en mangeant goulument, U. Tognazzi se fait masturber par une femme. Les pieds de M. Mastroianni pataugent dans les assiettes sales alors qu’il étreint une femme sur son lit.
Au début, les prostituées sont agréablement surprises de participer à une fête d’une telle opulence. Mais bientôt épuisées par le rythme frénétique de la débauche, elles prennent peur et refusent de devenir les témoins de l’agonie des bourgeois : « Vous êtes grotesques ! Pourquoi vous forcez-vous à manger si vous n’avez pas faim ? ». La nourriture est en effet présentée dans une profusion qui provoque la nausée. Les deux chevreuils, deux douzaines de poulets de Bresse et les cinq agneaux ne sont qu’un aperçu du festin, sans compter les montagnes de purée en accompagnement, préparée avec soin par le chef U. Tognazzi.
Quelle est l’efficacité d’un tel traitement ? Le week-end touche à sa fin, les prostituées écœurées sont parties, et les bourgeois sont toujours vivants. Ce n’est toutefois pas la grande forme : U. Tognazzi frôle l’arrêt cardiaque d’avoir trop ri, M. Piccoli est victime de douloureux ballonnements et de flatulences tonitruantes, P. Noiret se fait diagnostiquer du diabète. Seul M. Mastroianni, qui scrute la déchéance physique de ses amis, semble solide comme un roc. Le suicide culinaire le terrifie parce qu’il est plus long que prévu : « Vous n’avez rien compris ! On peut pas mourir en mangeant ! ». Or, une institutrice (Andréa Ferréol) croisée par hasard, accepte d’accompagner les quatre amis jusqu’au bout. Elle est fascinée par l’entreprise morbide de ses joyeux lurons, tout comme eux sont tombés sous le charme de cette femme. Elle joue à la fois le rôle de leur amante et de leur mère de substitution. Andréa cède aux avances de M. Mastroianni pour mieux le convaincre de poursuivre l’orgie, mais il est soudain frappé d’impuissance. Comme le désir sexuel et l’appétit ne font désormais plus qu’un, M. Mastroianni ne peut en conséquence plus être en érection. Lui qui se revendique obsédé sexuel, cette brusque abstinence liée au dégoût de la nourriture le prive de raison de vivre, et ce de façon absolue.
Cependant, M. Mastroianni n’a pas abandonné ses amis. Il les a juste devancés, car l’envie de mourir s’était faite plus pressante. Mort de froid d’avoir passé la nuit dehors sous la neige, le cadavre glacé de M. Mastroianni est découvert au petit matin. Les bourgeois sont bouleversés, mais aussi encouragés à redoubler les festivités. Andréa les assiste dans la mort : M. Piccoli, sous le coup de la dysenterie, s’effondre dans une flaque d’excréments. Ensuite, l’estomac d’U. Tognazzi éclate alors qu’il jouit d’une masturbation accomplie par Andréa. Enfin, P. Noiret, ravagé par le diabète, s’écroule dans les seins d’Andréa. Au terme du film, un camion frigorifique de chez Fauchon vient livrer une importante quantité de nourriture. Les cadavres des bourgeois se trouvant à l’intérieur de la villa, Andréa demande aux livreurs de déposer la viande « dans le jardin ». Les kilos de viande sont étalés au sol, au grand régal des chiens, tandis qu’Andréa retourne dans la villa pour se suicider.
La grande bouffe est avant tout une farce : U. Tognazzi imite Marlon Brando dans Le Parrain et M. Piccoli déclame du Shakespeare à une tête de veau ! Loin de l’image de la préciosité de la classe sociale bourgeoise, la nourriture est amplement gaspillée. Les repas se changent en batailles enfantines où tout le monde s’éclabousse à coup de parts de gâteau ou d’ailes de poulet. Le film multiplie les effets scatologiques, notamment par le rendu sonore de la mastication, des vomissements ou des émissions de gaz intestinaux. L’apothéose demeurant M. Mastroianni, couvert d’excréments pour avoir détruit un siège de toilette dans un élan de colère.
 L’erreur serait de faire l’amalgame entre le sujet et l’objet, il s’agit moins d’un film obscène que d’un film sur l’obscénité. Les personnages portent les véritables noms des acteurs. Cette absence de distanciation entre le rôle et la vie des acteurs change le rapport du spectateur au film, devenu malgré lui le voyeur de l’intimité de quatre amis, occupés non pas à manger pour vivre, mais à manger pour mourir. La grande bouffe dépasse la seule dénonciation des vices de la classe bourgeoise en interrogeant notre rapport au plaisir et à la culpabilité. La moitié de la planète souffre de malnutrition tandis que l’autre étouffe sous la surconsommation. Les dialogues soulignent l’horreur de la situation : « Mange encore ! Si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Pense que tu es un petit Indien à Bombay, qui a faim ». La farce est satirique : les bourgeois deviennent progressivement les bêtes qu’ils dévorent. Cloîtrées dans une porcherie, ils meurent comme tels : congelé, vidé de leurs tripes, estomac gavé à en éclater, diabète. La conclusion où des bouchers installent du bétail mort dans la cour désarçonne le spectateur. Ce gâchis culotté, qui est la dernière image du film, présente un tableau gravé à jamais dans les mémoires, à la manière de la toile La bacchanale (1615) de Rubens.
L’erreur serait de faire l’amalgame entre le sujet et l’objet, il s’agit moins d’un film obscène que d’un film sur l’obscénité. Les personnages portent les véritables noms des acteurs. Cette absence de distanciation entre le rôle et la vie des acteurs change le rapport du spectateur au film, devenu malgré lui le voyeur de l’intimité de quatre amis, occupés non pas à manger pour vivre, mais à manger pour mourir. La grande bouffe dépasse la seule dénonciation des vices de la classe bourgeoise en interrogeant notre rapport au plaisir et à la culpabilité. La moitié de la planète souffre de malnutrition tandis que l’autre étouffe sous la surconsommation. Les dialogues soulignent l’horreur de la situation : « Mange encore ! Si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Pense que tu es un petit Indien à Bombay, qui a faim ». La farce est satirique : les bourgeois deviennent progressivement les bêtes qu’ils dévorent. Cloîtrées dans une porcherie, ils meurent comme tels : congelé, vidé de leurs tripes, estomac gavé à en éclater, diabète. La conclusion où des bouchers installent du bétail mort dans la cour désarçonne le spectateur. Ce gâchis culotté, qui est la dernière image du film, présente un tableau gravé à jamais dans les mémoires, à la manière de la toile La bacchanale (1615) de Rubens.
La Grande Bouffe au meilleur prix
Portier de nuit (Liliana Cavani, 1974)
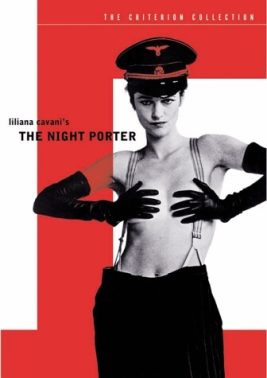
Maximilian Theo Aldorfer (Dirk Bogarde) mène une vie morne de portier de nuit dans un grand hôtel de Vienne en 1957. Les services secrets israéliens sont alors en pleine chasse aux criminels nazis. Le « gros poisson » Adolf Eichmann est capturé en pleine rue par les agents du Mossad, à Buenos Aires le 11 mai 1960. C’est dans ce climat paranoïaque que Max se voit convié à une réunion d’anciens dignitaires nazis. Même si Max est un « petit poisson », ses vieux complices craignent que le Mossad remonte jusqu’à eux s’il se fait prendre. La réunion secrète a pour but de transmettre toutes les preuves compromettantes dont Max dispose, ainsi que l’identité des derniers témoins gênants.
Max était « docteur » dans un camp d’extermination, et il affirme qu’aucun de ses « malades » n’est ressorti vivant de son « infirmerie ». Il faut dire que la « médecine » de Max, composée d’humiliations et de tortures, était radicale. Pourtant, le monde de Max s’écroule lorsqu’un célèbre chef d’orchestre arrive dans l’hôtel où il travaille, accompagné de sa femme Lucia (Charlotte Rampling). Douze années à parfaire une fausse identité s’évanouissent en un regard. Les deux anciens amants se reconnaissent immédiatement et restent stupéfaits par cette rencontre accidentelle.
Lucia n’est pas seulement une rescapée juive des camps d’extermination. C’est surtout la seule survivante des jeux pervers de Max.Comment Lucia a-t-elle pu résister au « traitement » dispensé à « l’infirmerie » de Max ? Flashback. Raflée à quinze ans, Lucia défile nue devant les SS avec les autres prisonniers juifs. Max est subjugué par la beauté blafarde du corps émacié de Lucia, si bien qu’il la sauve pour mieux la remodeler selon ses souhaits. Lucia résiste autant qu’elle peut au processus de déshumanisation, mais la peur de mourir est trop forte. Telle une esclave, elle doit se plier à tous les bizarreries et sévices possibles… et en redemander ! En échange, elle reçoit des traitements de faveur, telle la mort d’un prisonnier qui l’importunait. La « dialectique du maitre et de l’esclave » propre à Hegel fait qu’au final, c’est le maitre qui devient dépendant de son esclave. La dépendance de Max à l’égard de Lucia n’a pas faibli en 1957 : il risque sa vie en cachant l’existence de son ancienne esclave à ses complices de la SS.
Ni Max ni Lucia ne sont sortis indemnes du camp nazi. Max est toujours hanté par les actes répréhensibles qu’il a commis : « Je ressens de la honte quand je suis en pleine lumière ». Il est devenu réceptionniste de nuit, car ce n’est pas un « nazi de cœur » comme les vieux SS qui se déclarent fiers d’avoir appartenu « à la fine fleur du IIIe Reich ». Max se moque d’eux en ponctuant la réunion par « Heil Hitler ». Tous les vieux nazis répondent à son signal en levant mécaniquement le bras droit au ciel, alors que ce salut n’a plus aucune cohérence : la guerre est terminée, Adolf Hitler est mort depuis longtemps, le nazisme répugne le monde entier. Quant à Lucia, aussi problématique et immoral que cela puisse être, le lien sexuel qui l’unissait à Max était si fort dans le camp d’extermination qu’il se réactive dès qu’elle reconnait son bourreau à l’hôtel. Lucia a tellement pris goût à la cruauté que lui infligeait éperdument Max qu’elle recrée les conditions de sa soumission : « Il n’y a pas de guérison possible ».
Le moteur du couple repose sur la honte de souvenirs partagés. Max se dégoute parce qu’il a fui le procès de Nuremberg, et qu’il n’a jamais payé aux yeux du monde pour ses crimes. Lucia ressent une profonde culpabilité d’avoir survécu aux camps d’extermination, de surcroit par des moyens qui l’ont considérablement avilie. Chacun voit dans l’autre le terrible secret qui les ronge depuis plus de dix ans. Pour se purger de leur noirceur, les deux amants entament un nouveau cycle sulfureux, sur le modèle du précédent. Le présent se superpose au passé : mêmes fellations, mêmes costumes de SS et de victime juive, mêmes mises en scène masochistes. La frontière entre la passion d’hier et celle d’aujourd’hui devient difficile à percevoir, preuve que le traumatisme subi par Lucia est toujours aussi vif.
 De nombreuses scènes sont dérangeantes, sans pour autant être insoutenables : le nazisme n’est pas montré pour ses crimes racistes, mais pour sa dimension érotique via les accessoires fétichistes du pouvoir. Il faut voir Lucia dans sa panoplie masochiste : casquette à tête de mort sur la tête, seins nus, longs gants et bottes de cuir. Une autre scène la montre marcher à quatre pattes, avec un collier de chien et une longue chaine autour du cou. Même le délabrement physique et psychologique de Lucia se répète. Max sait qu’il ne pourra pas protéger éternellement Lucia des nazis. Retranchés dans l’appartement de Max, les amants sont plongés dans une insupportable famine puisque les vieux nazis interceptent leurs livraisons de nourriture. À bout de force, le couple décide d’enfin sortir pour révéler au monde l’amour fou d’un ancien SS et d’une rescapée des camps d’extermination. Max et Lucia affrontent la lumière du jour en même temps que leurs plus noirs démons, ce qui rappelle la toile La mort de Cléopâtre (1892) de Reginald Arthur.
De nombreuses scènes sont dérangeantes, sans pour autant être insoutenables : le nazisme n’est pas montré pour ses crimes racistes, mais pour sa dimension érotique via les accessoires fétichistes du pouvoir. Il faut voir Lucia dans sa panoplie masochiste : casquette à tête de mort sur la tête, seins nus, longs gants et bottes de cuir. Une autre scène la montre marcher à quatre pattes, avec un collier de chien et une longue chaine autour du cou. Même le délabrement physique et psychologique de Lucia se répète. Max sait qu’il ne pourra pas protéger éternellement Lucia des nazis. Retranchés dans l’appartement de Max, les amants sont plongés dans une insupportable famine puisque les vieux nazis interceptent leurs livraisons de nourriture. À bout de force, le couple décide d’enfin sortir pour révéler au monde l’amour fou d’un ancien SS et d’une rescapée des camps d’extermination. Max et Lucia affrontent la lumière du jour en même temps que leurs plus noirs démons, ce qui rappelle la toile La mort de Cléopâtre (1892) de Reginald Arthur.
Portier de Nuit au meilleur prix
Salò ou les 120 jours de Sodome (Pier Paolo Pasolini, 1975)

Avril 1944. La république de Salo est à l’Italie ce que le régime de Vichy est à la France, un État totalitaire dépendant du IIIème Reich. Or, l’Allemagne nazie agonise, sur le point d’être vaincue tant sur les fronts extérieurs que par les forces intérieures de la Résistance dans les pays occupés. Quatre vieux dignitaires du régime fasciste – un duc, un évêque, un juge et un président – décident de profiter du peu de temps qu’il leur reste avant que la guerre ne les rattrape. Ils établissent un programme basé sur le livre Les cent vingtjournées de Sodome(1785) du marquis de Sade.
Les notables commencent par épouser mutuellement leurs filles. Puis, ils ordonnent aux soldats de la Wehrmacht et aux miliciens italiens de chercher quatre prostituées, d’enlever neuf garçons et neuf filles de la campagne environnant Salo, et de les séquestrer dans une luxueuse villa.
Le film se divise en cinq tableaux. Le « vestibule de l’enfer » plante le décor : « Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort ». Le « cercle des passions » est une parodie du mariage dans laquelle deux adolescents doivent procéder à une nuit de noce publique. Tous les adolescents enlevés sont nus, réduits à l’état de chiens tenus en laisse par les soldats fascistes. Les prisonniers marchent à quatre pattes, aboient, se nourrissent dans des gamelles posées sur le sol. L’évolution est renversée : l’humanité retourne à la bestialité. La domination des bourreaux est absolue. Le « cercle de la merde » est une parodie de la société de consommation. La nourriture d’un banquet est remplacée par les excréments de tous les pensionnaires de la villa, soigneusement récupérées dans une immense cuve. Le « cercle du sang » est une parodie de l’ère nazie et fasciste : pour échapper à la répression, les adolescents dénoncent l’un après l’autre à leurs tortionnaires les vices de leurs voisins. La chaine des dénonciations conduit les notables jusqu’au lit d’un milicien italien, en train de faire l’amour avec une domestique Noire. Les notables criblent de balles le couple non conforme à leurs idéaux racistes, comme s’il s’agissait d’une exécution publique de résistants.
Le dernier cercle ne porte pas de nom. Il s’agit d’une surprise réservée aux jeunes esclaves qui auraient désobéi au règlement. En fait, personne n’est innocent selon ce règlement, changé selon le bon vouloir des notables. Mais les prisonniers acceptent tout, jusqu’aux ordres les plus cruels et dégradants, parce qu’ils ont l’espoir de sortir un jour de la villa : « Dans la mesure où vous voudrez collaborer, vous pourrez espérer venir avec nous à Salo ». Mais les notables, aidés de leur milice armée, ont en réalité un tout autre plan pour leurs victimes. Ce plan est exposé lorsque leur prend l’envie d’élire l’esclave dont « le cul est le plus admirable » pour le tuer. L’arme chargée d’exécuter l’esclave n’est en réalité pas chargée : « Imbécile ! Comment pouvais-tu penser que nous voulions te tuer ? Ne sais-tu pas que nous voudrions te tuer mille fois, jusqu’aux limites de l’éternité, si l’éternité pouvait avoir des limites ». Dernier acte. Le duc s’installe sur un trône situé près de la fenêtre, et examine à la jumelle ses complices torturer à mort les jeunes victimes. Les notables s’échangent à tour de rôle le trône pour admirer la besogne des autres dans la cour en contrebas.
Salo ou les 120 jours de Sodome est le film italien le plus dérangeant. La transposition de l’œuvre du marquis de Sade au crépuscule de l’Italie fasciste est éclairante. Lors de la conférence « La chiennerie de Sodome. Silling, la matrice du camp de concentration », le philosophe Michel Onfray explique comment les écrits du marquis de Sade préfigurent la barbarie des camps de concentration : « Les 120 journées de Sodome rédigées par un Marquis délinquant sexuel avéré mettent en scène des milices, des rafles, des camps, des tontes, des tatouages, des tortures, des fours… ». Royaume de la décadence et de l’injustice, la République de Salo correspond à l’esprit du livre du divin marquis : entre septembre 1943 et août 1945, 72 000 personnes sont exécutées et 40 000 sont mutilées. La cruauté sadienne s’incarne à merveille dans les symboles de l’institution fasciste (le duc : la noblesse, l’évêque : l’Église, le juge : la magistrature, le président : la finance, la milice : l’armée).

Le film ne peut se résumer à l’étalage complaisant de la torture, du meurtre ou de la pornographie. L’érotisme est absent du film car la jouissance des bourreaux n’est pas associée à la grâce du corps, mais à sa dépravation dans la scatologie, à sa mutilation, puis à sa mise à mort en un spectacle orgiaque. Si les vieux notables scrutent avec avidité leurs soldats violer les prisonniers, c’est tout juste s’ils éprouvent eux-mêmes du plaisir en se masturbant ou en se faisant sodomiser. La vérité, c’est que les notables sont trop avilis pour jouir autrement, comme en témoigne la présence de quatre professionnelles du sexe : « indispensables éléments d’excitation », ou la frustration de l’évêque, qui abandonne temporairement l’orgie : « Les efforts pour me satisfaire seraient maintenant énormes et bien au-delà des péchés réellement véniels qu’il eut suffi auparavant ».
La scène la plus marquante est celle où le duc défèque devant une esclave et lui ordonne de manger ses excréments à la petite cuillère. Une autre scène dérangeante montre les prisonniers entassés autour de la cuve à excréments. Ils ont enfin compris que rien n’arrêtera la folie des notables : « Mon dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? ». Le pire, c’est qu’ils ne peuvent rien tenter, ni se suicider ni se révolter, car leurs mains sont liées et la milice armée les surveille. Et puis surtout, les esclaves ont été trop déshumanisés pour avoir encore le goût de vivre. Le film se conclut par un massacre, puis une danse improvisée par les notables et les miliciens, signant la fin des festivités. Si Le dernier tango à Paris faisait référence à la peinture de Francis Bacon, la lente danse macabre de Salo ou les 120 jours de Sodome évoque les supplices de l’enfer du « Jardin des délices » (1503) de Jérôme Bosch.
Salò ou Les 120 Jours de Sodome au meilleur prix
Affreux, sales et méchants (Ettore Scola, 1976)
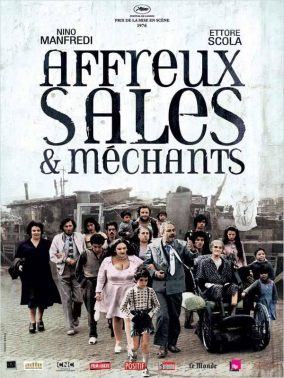
Un bidonville perdu dans les faubourgs de Rome à la fin des années 1960. La vie dans les « borgates » est une réalité pour plus de 800 000 Italiens, survivant dans des abrits construits sans permis, sans eau ni électricité. Giacinto Mazzatella (Nino Manfredi) règne en tyran dans l’un de ces immondes taudis.
Sa mère, sa femme, ses enfants, leurs conjoints, leurs amants… au total une vingtaine de personnes toutes plus laides, dégoutantes et cruelles les unes que les autres vivent sous son toit : « C’est ma maison, ici ! Je l’ai construite de mes mains, tôle après tôle. Vous y habitez comme à l’hôtel, mais gratuitement, sans sortir un sou ! ». Giacinto ne supporte plus sa famille, dont les membres se reproduisent à une vitesse qui excède largement la capacité d’accueil de sa borgate. La grand-mère, prostrée dans un siège de voiture monté sur deux roues de vélo en guise de fauteuil roulant, inflige à tous la voix de la télévision. La femme de Giacinto le trompe et lui laisse des enfants qu’il ne reconnait pas : « C’est pas mon fils ! Il est né alors que j’ai passé deux ans en taule ! ». Les adolescents qui n’ont pas atteint leur maturité sexuelle travaillent à l’entretien du bidonville, les autres se prostituent ou sombrent dans la délinquance. Les enfants sont laissés à eux-mêmes dans une cage géante pour toute école. La lutte constante pour subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille exponentielle rend amer Giacinto : « La famille, c’est comme la merde : plus c’est proche et plus ça pue ! ».
Les membres du clan Mazzatella accepte l’autorité de Giacinto pourvu qu’elle soit temporaire : chacun espère en secret lui voler sa fortune, et s’arracher de la misère en solitaire. Giacinto cache effectivement un butin estimé à un million de lires, reçu en dédommagement suite à « un accident du travail ». En vérité, la pauvreté a poussé Giacinto à recourir à une solution extrême : s’automutiler pour obtenir une aide financière. Il perd un œil en se brulant le visage à la chaux vive, et réussit à extorquer de l’argent à son assurance. Giacinto ne cesse de menacer ou de frapper ceux qui se montrent trop pressés de lui voler sa fortune. S’adressant à l’un de ses fils qui démarre un scooter à l’intérieur du taudis : « Je vais te la démolir ta vespa ! Il vit sans sortir un sou ! Et c’est même pas mon fils ! Il est né fils de pute ! Mais je vais tous vous foutre dehors ! Je vous mettrai une balle dans la tête ! ».
Un jour d’ivresse, Giacinto ramène une prostituée chez lui, ce qui a pour effet de liguer le clan tout entier contre lui. Cette crapule risque de dépenser son magot pour une inconnue alors que sa famille manque de tout. De la grand-mère au petit-fils, tous se rendent complices de l’assassinat de Giacinto en lui préparant un banal plat de pâtes, assaisonnées aux aubergines et à la mort aux rats. Lorsque Giacinto réalise avec angoisse qu’il a été empoisonné, il dispose de peu de temps pour se faire un lavage d’estomac. Une impressionnante lutte pour la survie commence, lors de laquelle Giacinto gagne aussi vite que possible le bord de la mer. Il ingurgite à la hâte une grande quantité d’eau de mer à l’aide d’une pompe à vélo, ce qui le force à vomir la dose mortelle de poison. De rage, il chasse les siens et met le feu à son taudis : « Vous vouliez ma maison, prenez là ! Maintenant elle a même le chauffage ! ».
 La dernière scène est particulièrement éprouvante. Giacinto finit par reprendre la tête de son clan, car malgré toute la haine et la violence dont il est capable, il n’a pas le cœur d’abandonner des enfants en bas âge. Le clan Mazzatella s’est considérablement agrandi depuis le début du film, rognant les derniers espoirs d’émancipation de chacun de ses membres. L’adolescente qui rêvait au début de poser nue dans les magazines érotiques locaux ne le pourra jamais : elle est désormais enceinte. Au contact de la société de consommation, les communautés minoritaires n’ont pas seulement perdu leur culture et leur mode de vie, mais également leur solidarité et leur dignité. La télévision diffuse continuellement l’idéal de bien être de l’idéologie dominante, idéal inaccessible pour ceux qui sont maintenus en dehors de Rome. Les habitants des borgates sont trop occupés à se haïr entre eux pour s’unir et être en capacité de se révolter. Le film nous décrit des êtres terriblement frustrés, prêts à tout pour satisfaire les nouveaux besoins que la société de consommation leur impose. Ce film s’adresse à ceux qui sont responsables des bidonvilles par leur gestion ignoble du pouvoir politique et de la répartition des richesses : les pauvres sont des victimes affreuses, sales et méchantes… et c’est de votre faute. L’Italie des années 1960, et donc la portée du film, n’est pas périmée : il suffit de remplacer le contexte du bidonville romain par un campement de fortune dans la banlieue parisienne pour voir rejaillir la même misère. L’état d’urgence dans Affreux, sales et méchants évoque la toile L’incendie (1850) de Alexandre Antigna.
La dernière scène est particulièrement éprouvante. Giacinto finit par reprendre la tête de son clan, car malgré toute la haine et la violence dont il est capable, il n’a pas le cœur d’abandonner des enfants en bas âge. Le clan Mazzatella s’est considérablement agrandi depuis le début du film, rognant les derniers espoirs d’émancipation de chacun de ses membres. L’adolescente qui rêvait au début de poser nue dans les magazines érotiques locaux ne le pourra jamais : elle est désormais enceinte. Au contact de la société de consommation, les communautés minoritaires n’ont pas seulement perdu leur culture et leur mode de vie, mais également leur solidarité et leur dignité. La télévision diffuse continuellement l’idéal de bien être de l’idéologie dominante, idéal inaccessible pour ceux qui sont maintenus en dehors de Rome. Les habitants des borgates sont trop occupés à se haïr entre eux pour s’unir et être en capacité de se révolter. Le film nous décrit des êtres terriblement frustrés, prêts à tout pour satisfaire les nouveaux besoins que la société de consommation leur impose. Ce film s’adresse à ceux qui sont responsables des bidonvilles par leur gestion ignoble du pouvoir politique et de la répartition des richesses : les pauvres sont des victimes affreuses, sales et méchantes… et c’est de votre faute. L’Italie des années 1960, et donc la portée du film, n’est pas périmée : il suffit de remplacer le contexte du bidonville romain par un campement de fortune dans la banlieue parisienne pour voir rejaillir la même misère. L’état d’urgence dans Affreux, sales et méchants évoque la toile L’incendie (1850) de Alexandre Antigna.
Affreux, sales et méchants au meilleur prix
Caligula (Tinto Brass, 1979, 2h30)
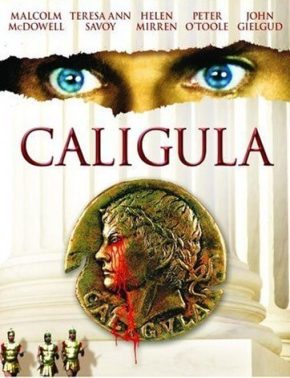
Rome païenne. Caius Caligula (Malcolm McDowell), arrière-petit-fils d’Auguste, est le fils adoptif du deuxième empereur romain, Tibère (Peter O’Toole). Le règne de Tibère est marqué par des orgies, mais aussi par de la répression et des complots qui le rendent impopulaire auprès du peuple. Tibère commanda en sous-main l’assassinat de nombreux membres de sa propre famille, soupçonnés de vouloir le tuer pour prendre sa place. Caligula est l’un des derniers prétendants à sa succession, et risque fort de subir le sort de ses prédécesseurs. Avide de prendre les rênes du pouvoir, il étrangle Tibère de ses mains. Le meurtrier se fait sacrer empereur à 26 ans, au grand soulagement du peuple.
Les huit premiers mois de règne du nouvel empereur soulèvent l’enthousiasme du peuple. Cependant, la mort de la sœur de Caligula, Drusilla (Teresa Ann Savoy) va tout bouleverser. Caligula se rend brutalement compte qu’être l’homme le plus puissant au monde ne le rend pas invulnérable pour autant. Il est forcé d’admettre, comme le dit Albert Camus dans sa pièce de 1944, que « Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». Dès lors, Caligula ne va plus avoir qu’une obsession : jouir de façon absolue pendant le temps qu’il lui reste à vivre, quitte à ce que Rome explose sous le poids de ses caprices. La maxime de Tibère : « Qu’ils me haïssent pourvu qu’ils m’approuvent » se change dans la bouche de Caligula en : « Qu’ils me haïssent, pourvu qu’ils me craignent ! ».
Au lieu d’être défié une fois mort, comme ces prédécesseurs, l’empereur se prend pour Jupiter et ordonne qu’on le vénère comme un dieu de son vivant. Pour s’assurer du soutien du peuple, il fait organiser de nombreux jeux au cirque. Preuve de sa démence, il reporte l’amour de Drusilla sur Incitatus, le meilleur cheval de son écurie. Il couche avec Incitatus, lui fait bâtir une maison, et le fait même nommé consul pour humilier le sénat. Son mépris pour les institutions de la vieille république qui voudrait limiter ses privilèges atteint son paroxysme lorsqu’il contraint les femmes et les filles des sénateurs à se prostituer. Caligula va même jusqu’à détourner le salut impérial en achevant son geste par un brutal fist-fucking. Un complot se trame, les soldats chargés de la sécurité de l’empereur tyrannique l’assassinent à l’âge de 29 ans. Les sénateurs mettent à la place son oncle, Claudius (Giancarlo Badessi), un niais aisément manipulable.
Le tournage de Caligula fut terminé en 1976. Pourtant, le film ne sortit en salles qu’en 1979. Que s’est-il passé pendant ses trois années ? Une guerre entre le scénariste Gore Vidal, le réalisateur Tinto Brass et le producteur Bob Guccione. La première bataille vint des exigences de G. Vidal, désireux que le film porte le titre de « Gore Vidal’s Caligula ». T. Brass mutila son scénario parce que le film devenait « trop long, trop cher et trop homosexuel ». Il faut savoir que G. Vidal défendait la cause homosexuelle à travers ses livres, alors que B. Guccione était dès 1969 le producteur du magazine machiste Penthouse aux États-Unis. La promotion de Caligula le vantait comme « le premier film non-pornographique contenant des scènes de sexe explicites ». L’intention de B. Guccione était de profiter de la notoriété des stars de Penthouse, en plus du casting conventionnel, pour assurer le succès du film. Il n’était pas question de faire de Caligula un héros homosexuel, ou d’organiser des orgies bisexuelles, au grand daim de G. Vidal : « Le véritable auteur du film Caligula est celui qui l’a écrit, pas le réalisateur Tinto Brass, un parasite, ou le producteur Bob Guccione, un grand pourvoyeur de l’univers en femmes-objets dénudées ».
La deuxième bataille eut lieu entre T. Brass et B. Guccione. Le réalisateur reléguait les scènes de sexe au second plan, ce qui a prodigieusement frustré B. Guccione. Le producteur utilisa le plateau de T. Brass pour tourner la nuit en secret de nouvelles scènes osées avec les stars de Penthouse. Au moment du montage final, T. Brass fut catastrophé par les scènes pornographiques ajoutées à son insu : « Je voulais réaliser un film sur l’origine du pouvoir, et Bob Guccione l’a transformé en film sur le pouvoir de l’Origine [allusion au tableau l’Origine du monde (1866) de Gustave Courbet]. Un film de cul, luxueux, certes, mais vulgaire. L’idée originale n’était pas de faire un film sur le sexe, mais sur le pouvoir, donc sur la violence. La violence sexuelle, selon ma mise en scène, ne devait être qu’une parabole de la violence du pouvoir. Lorsque Caligula se rend compte du piège dans lequel il est tombé, lorsqu’il s’aperçoit que ce n’est pas lui qui détient le véritable pouvoir mais que ce sont les institutions qui se sont servies de lui, le seul moyen qui lui reste, c’est de s’en remettre à la folie. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’il faut voir l’aspect pornographique du film, le sexe n’étant pas un élément d’excitation, mais de provocation à la morale, d’offense constante. Le thème de Caligula est celui du pouvoir, alors que l’érotisme n’est que mystification ».
Le film Caligula tente de réaliser une audacieuse synthèse de tous les films italiens précédents. Des Damnés, Caligula conserve la progression crescendo dans la perversité. Toutefois, si le film suggère que Caligula pratique la zoophilie avec son cheval et la nécrophilie avec sa sœur décédée, les scènes d’orgies les plus extravagantes ont lieu au début, sous le règne de Tibère. Loin des stars à la plastique parfaite de Penthouse, Tibère apprécie la pédophilie et les partouzes où se mêlent des êtres hors-norme : hermaphrodite, sœur siamoise, nain, femme à quatre mains, cyclope… La perversité sexuelle de Tibère fait place à des orgies plus classiques sous Caligula, mais aussi à des accès de cruauté extrêmement sophistiquée : le puissant préfet du prétoire Macron, attaché et enterré, se retrouve à la merci d’une immense machine à décapiter !
On retrouve le couple torturé du Dernier tango à Paris et du Portier de nuit : la relation incestueuse entre Caligula et Drusilla ne peut mener à un dénouement heureux. Drusilla se révèle au fil du temps incapable de réfréner ni la frénésie sexuelle ni la cruauté de l’empereur, qui brise ses sujets un à un comme le ferait un enfant avec ses jouets.
L’influence de La grande bouffe se retrouve dans le formidable gâchis que constituent certains décors : la « salle des plaisirs » de Tibère est montée sur trois étages, la « machine à décapiter » haute de 15 mètres se meut dans une arène géante, une gigantesque galère est construite à l’intérieur du palais impérial uniquement pour… accueillir une orgie ! Une véritable démonstration du pouvoir dans ce qu’il peut avoir de plus luxueux et fat.
La scène du mariage fastueux de Salò ou les 120 journées de Sodome est retranscrite quasiment telle quelle : même exhibition religieuse, et même viol des mariés par le souverain à la fin des cérémonies.
Après avoir supplié en vain la déesse protectrice Isis de ressusciter sa sœur, Caligula se rend compte qu’il n’est qu’un homme ordinaire destiné, lui aussi, à connaitre la mort. Cette révélation le fait divaguer et fuir son propre trône : il erre dans les quartiers déshérités de Suburre, et croise la misère de Affreux, sales et méchants. La crasse des ruelles, les esclaves réduits à du bétail contrastent avec les parures dorées du palais impérial.
Notre conclusion sur le cinéma érotique italien des années 1970
Les réalisateurs italiens se répondent par œuvres interposées, fascinés par la dégénérescence de la civilisation. Trois films partagent l’ère nazie comme toile de fond : la famille désagrégée par l’ambition des Damnés, le duo maitre / esclave de Portier de nuit, les fascistes à la fois tout-puissants dans leur villa, mais impuissants sexuels dans Salo ou les 120 journées de Sodome. Le couple impossible du Dernier tango à Paris se retrouve dans des conditions décuplées dans Portier de nuit. Les quatre amis prêts à mourir de plaisir dans La grande bouffe évoquent les quatre pervers de Salo ou les 120 journées de Sodome. Les mœurs décadentes des bourgeois dans La grande bouffe font écho à l’avilissement des pauvres dans Affreux, sales et méchants. Enfin, Caligula transpose les thèmes chers aux films précédents au temps des ancêtres romains, soulignant ainsi le lien archaïque, mais toujours aussi prégnant, entre érotisme et pouvoir. Comme si la civilisation était déjà viciée à l’origine, et que le reste ne pouvait que dégénérer.